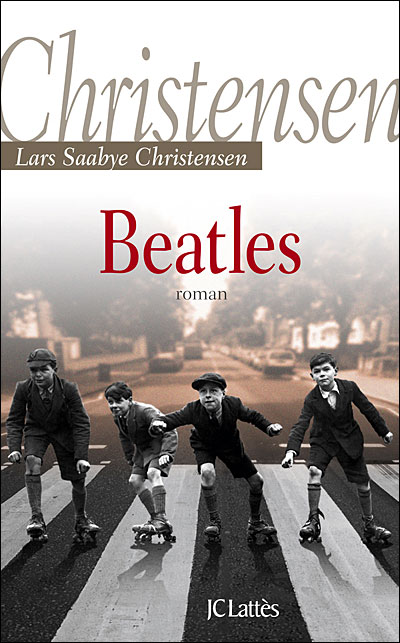La nouvelle livraison des éditions Lignes, un court essai, tous Coupat, tous coupables, écrit par le philosophe Alain Brossat sur l'affaire Tarnac — rappelez-vous cette rocambolesque affaire de terrorisme d'ultra-gauche ou anarcho-autonome c'est selon (dixit Alliot-Marie) mettant en cause de jeunes et brillants étudiants reconvertis dans le militantisme et accessoirement dans la gestion d'une épicerie — va indisposer tous les champions de l'antitotalitarisme et tous les thuriféraires de la démocratie de marché, des droits de l'homme et du moralisme démocratique. (Bernard-Henry Lévy, André Glucksmann, Pascal Bruckner...)
En effet, ce livre va à l'encontre de toute une doxa démocratique qui aujourd'hui représente l'agencement discursif dominant des sociétés capitalistes développées, susceptible de créer du consensus et de gommer les aspérités. Car pour Brossat, l'affaire Tarnac n'est qu'un moyen de prendre le pouls idéologique de nos sociétés et de voir où en sont les subjectivités politiques. Et, au-delà de l'affaire, ce qu'il analyse c'est la réaction qu'elle a suscitée dans les milieux intellectuels et plus particulièrement chez certain des intellectuels critiques les plus en vue. Il montre notamment que ceux qui, parmi les philosophes contemporains, ont travaillé de la manière la plus constante et la plus convaincante à la déconstruction du mythe utile de la démocratie réelle -- épinglée comme oligarchie effective chez un auteur comme Jacques Rancière, comme artifice pseudo-majoritaire chez Alain Badiou, comme ventriloque du néo-libéralisme triomphant chez Daniel Bensaid, comme otage du principe marchand de l'équivalence générale chez Jean-Luc Nancy, comme paravent de l'état d'exception chez Giorgio Agamben, comme fétiche du nihilisme contemporain chez Slavoj Zizek -- vont être conduit, à travers une pétition en défense des accusés, à remettre en selle le fétiche déboulonné sous la pression d'une sorte d'état d'urgence politique. Il montre donc que toute prise de position sur un plan politique est obligé de s'agencer au référent démocratique et cela indépendamment de toutes opinions philosophiques individuelles. Mais la vraie politique, "la politique passionnelle", non neutralisée par l'agencement discursif dominant, ne peut que se développer sous le paradigme de la division et du conflit alors que la démocratie moderne ne se présente que sous le régime de l'"un-seul", du bloc monolithique et consensuel. Donc, pour réactualiser la politique, pour lui permettre de remettre en cause l'ordre de la police, il est nécessaire de réactiver les subjectivités dissidentes, totalement hétérogènes au régime de l'"un seul". Pour cela, l'axiome "tous démocrates" ne peut suffire car il réunit dans un même consensus mou les subjectivités dissidentes et les subjectivités dominantes.
Alain Brossat nous offre ainsi, par ce court essai revigorant, loin de la bien-pensance et du politiquement-correct, une réflexion salutaire remettant en cause tous les fétiches de notre modernité. De plus ce livre se trouve être d'autant plus important, à une époque où tous le monde se réclame de ces fétiches démocratiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, du militarisme des faucons impérialistes américains aux élans humanistes et biopolitiques des associations humanitaires, bref à l'heure où le "tous démocrates" fait encore consensus.
Romain DAUTCOURT
Romain DAUTCOURT